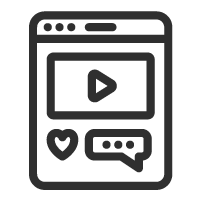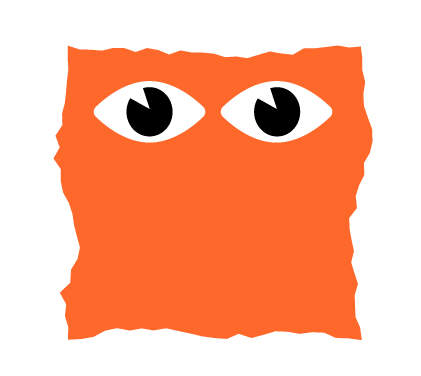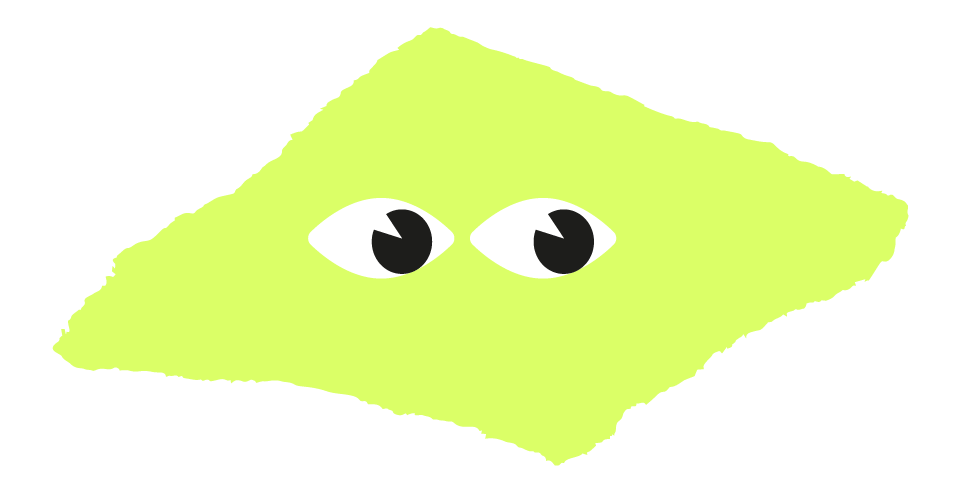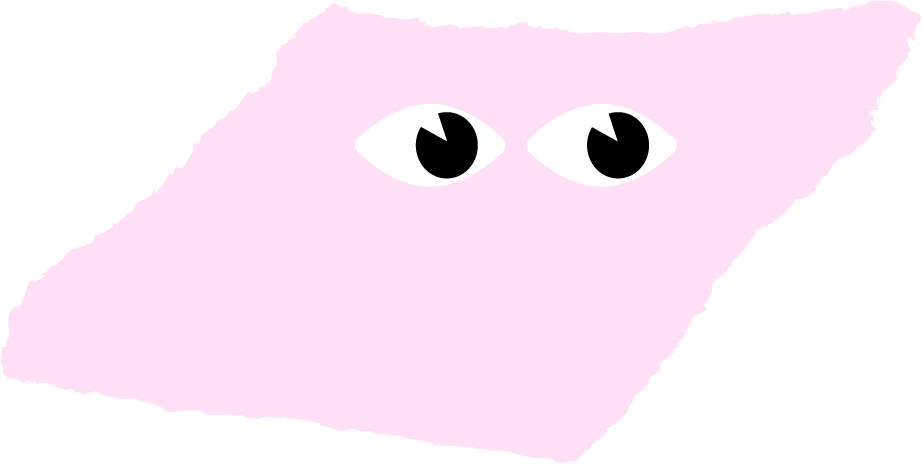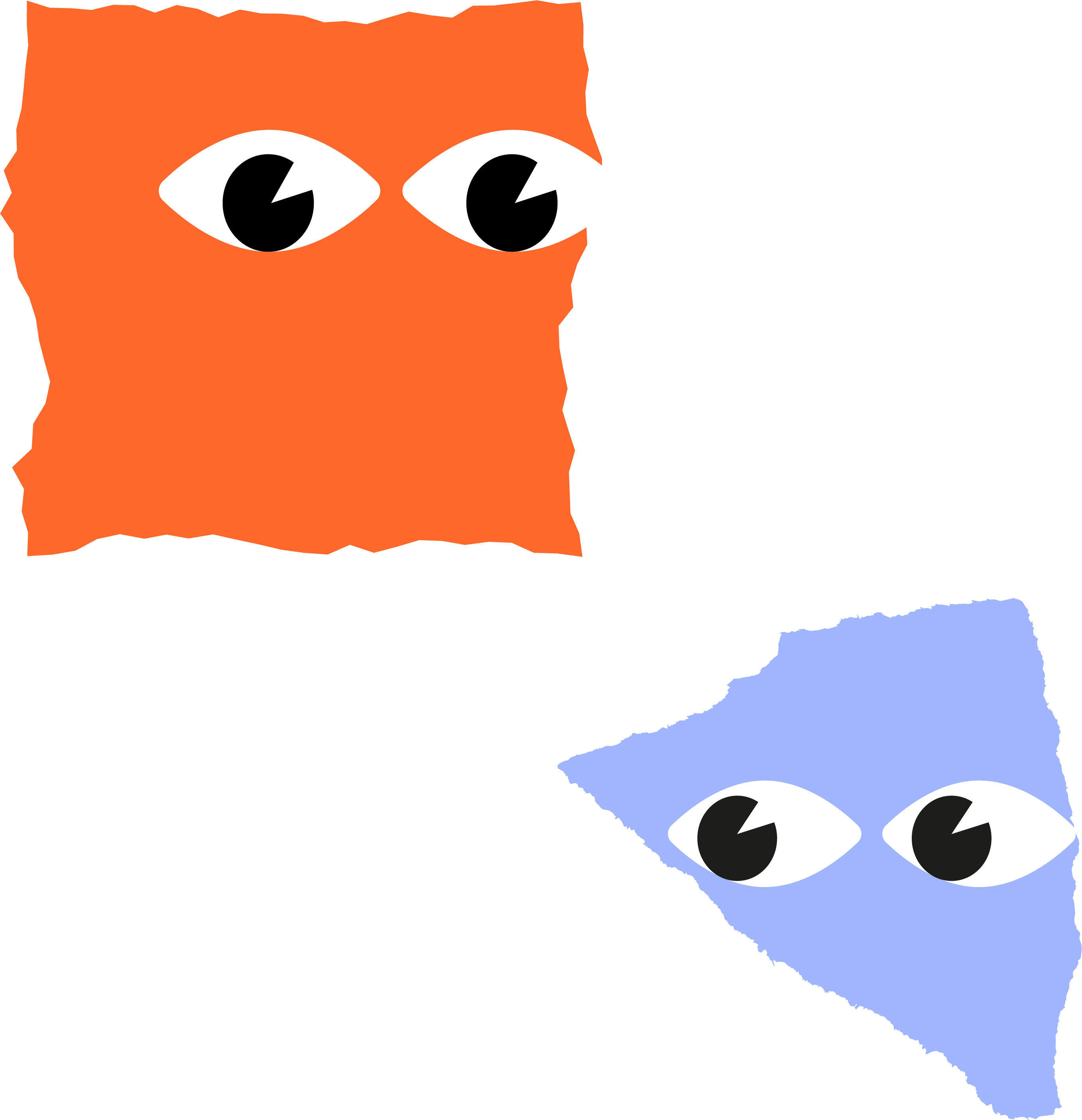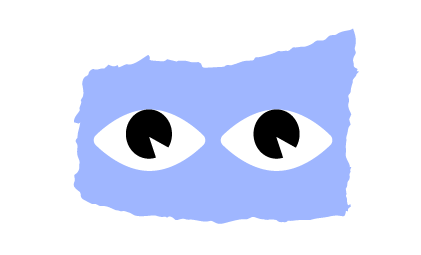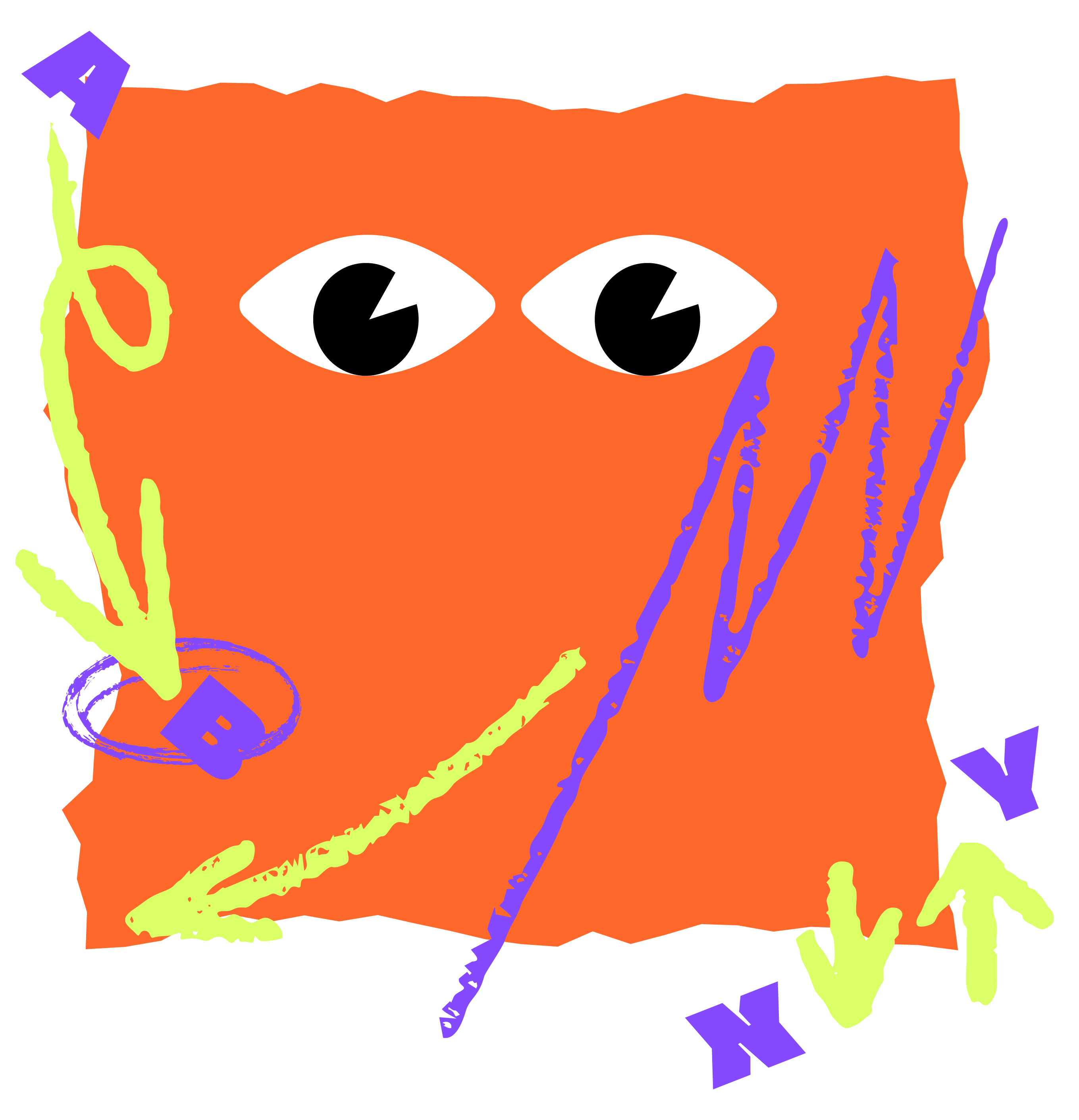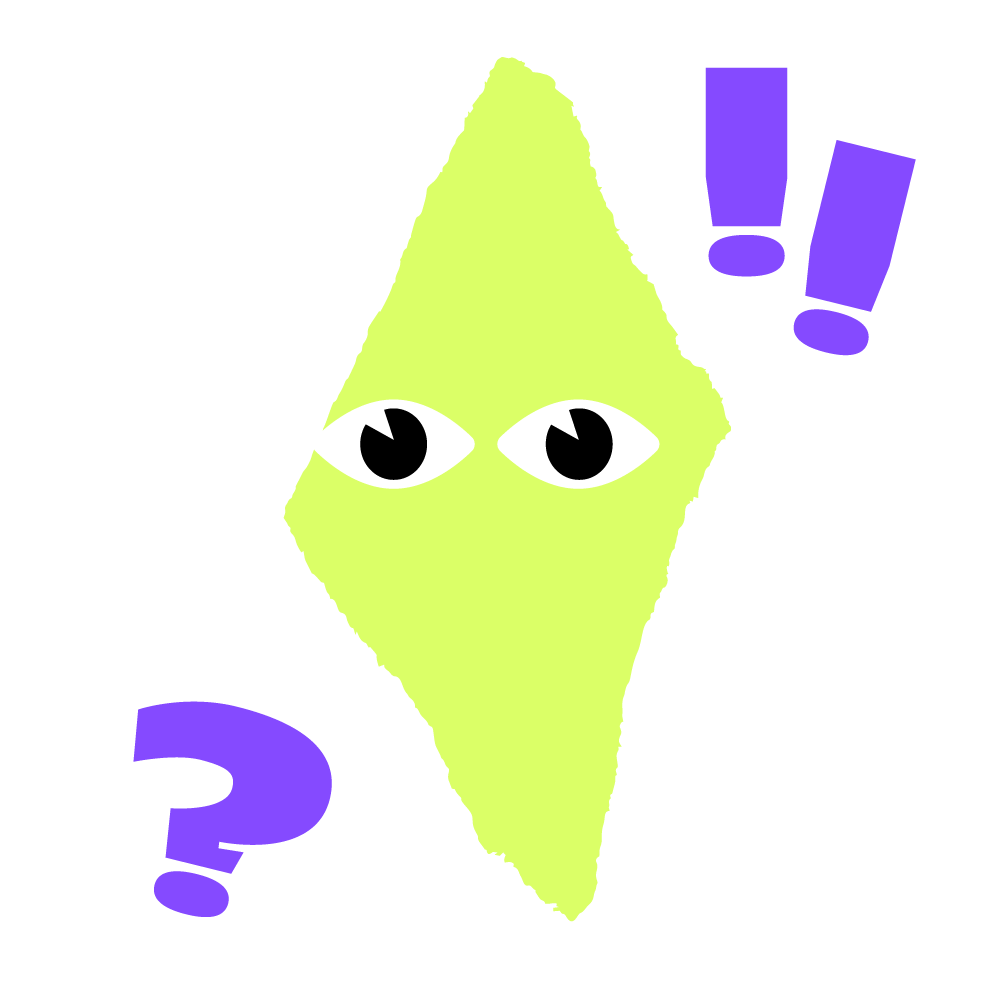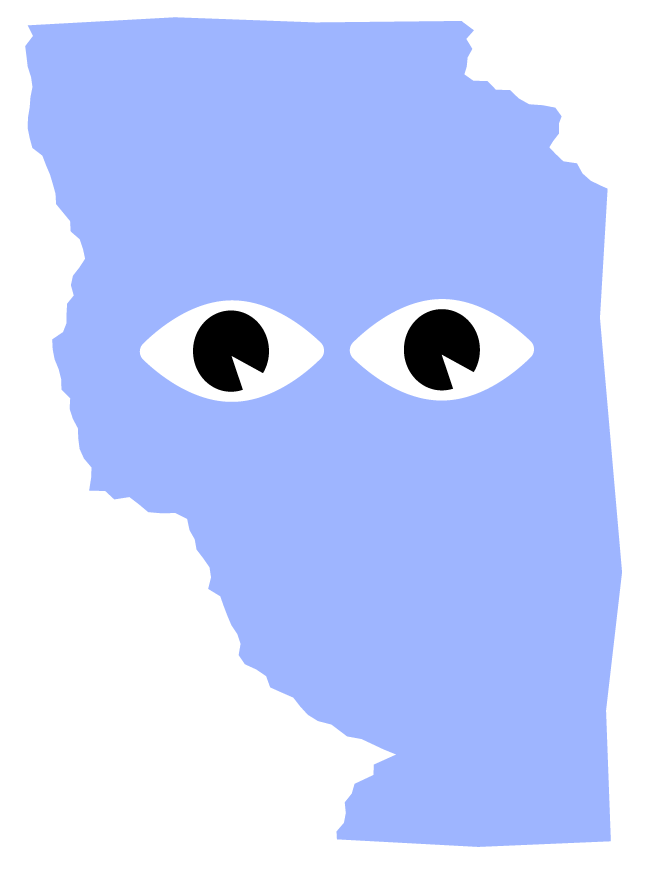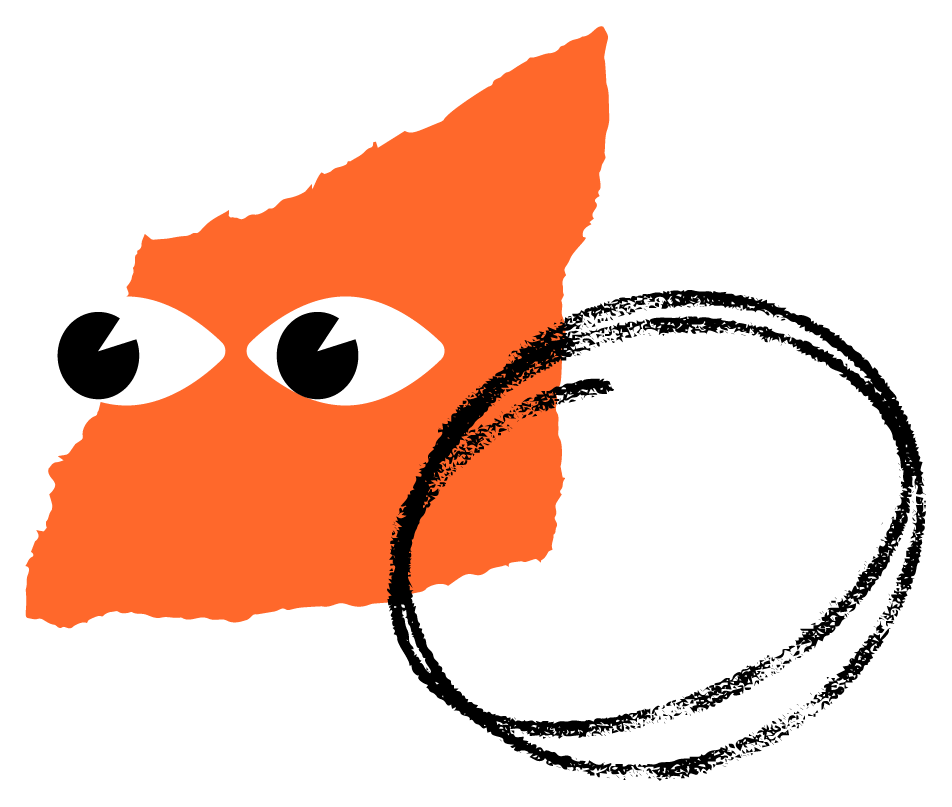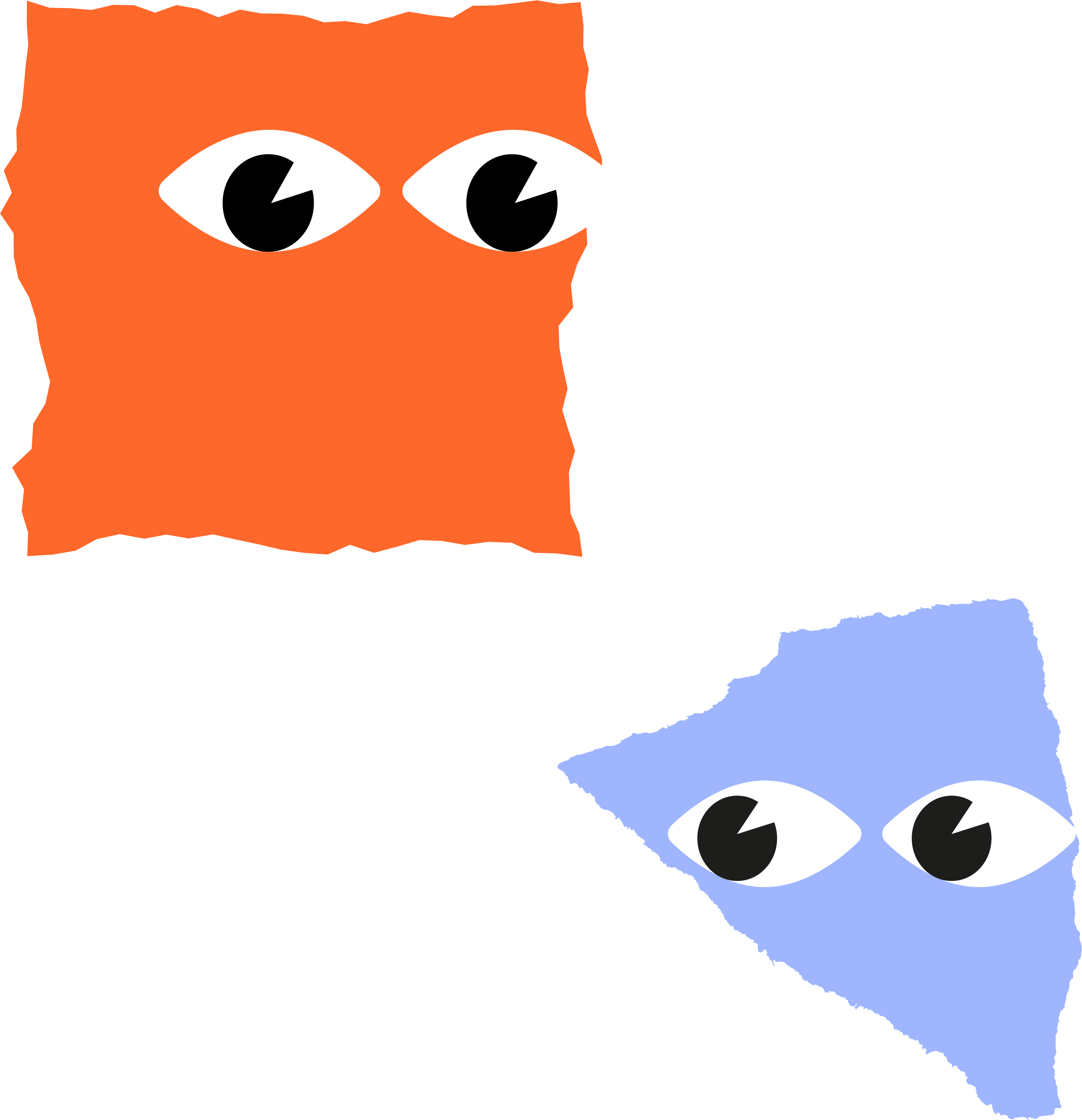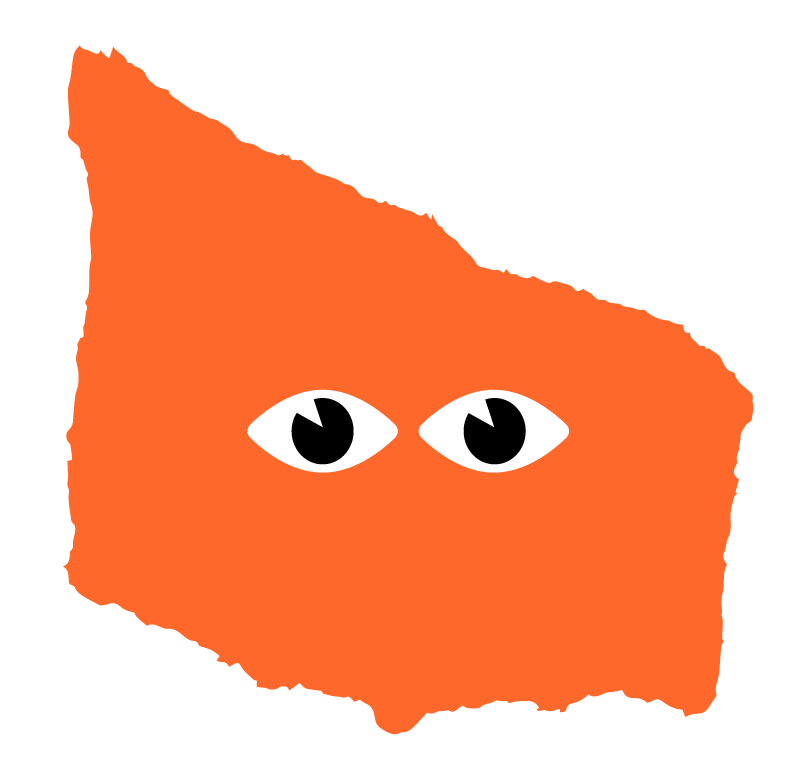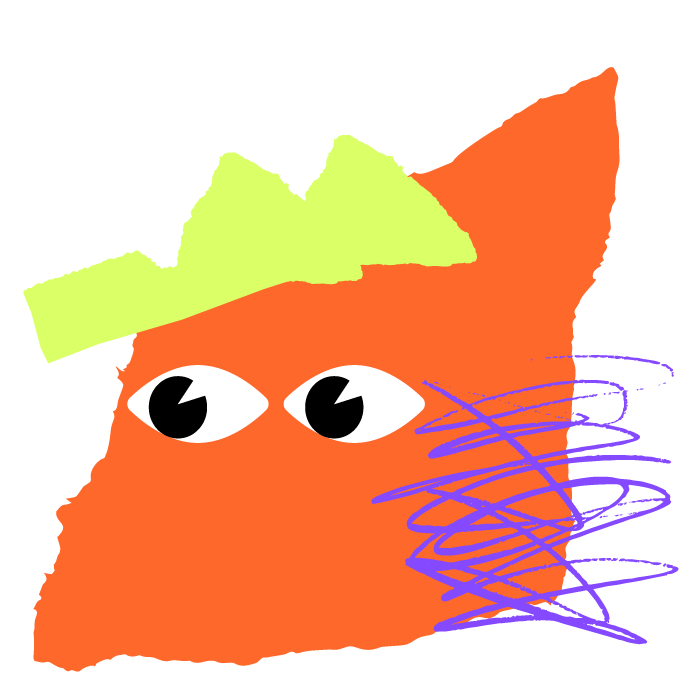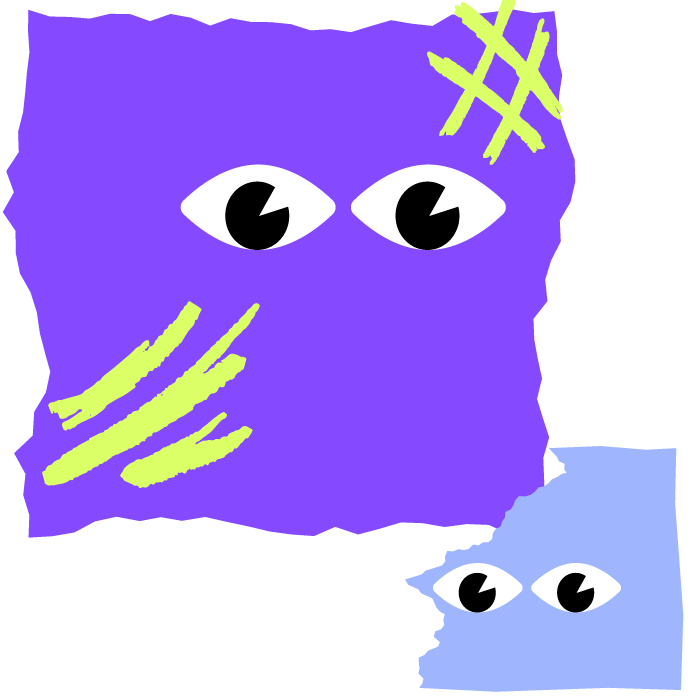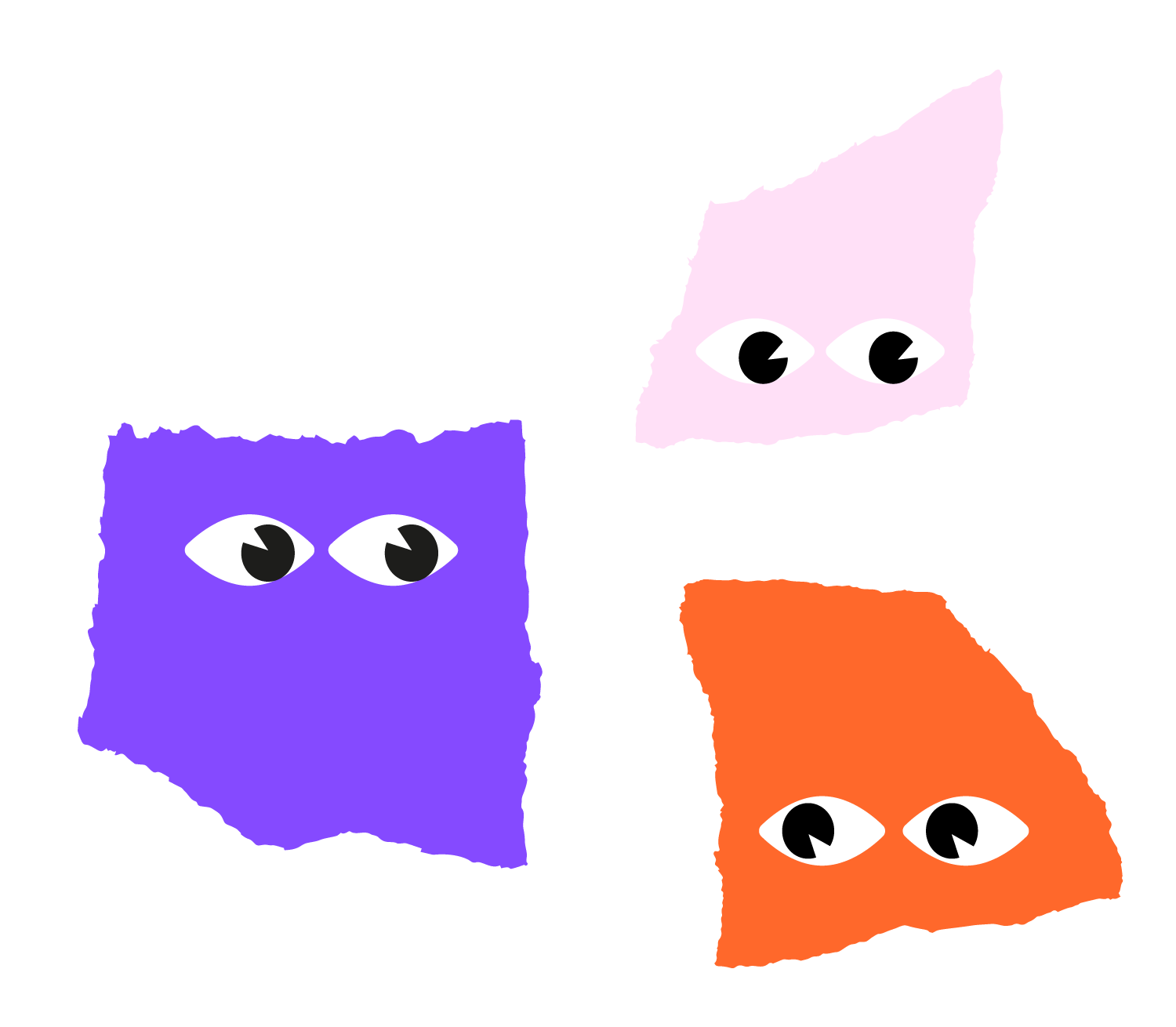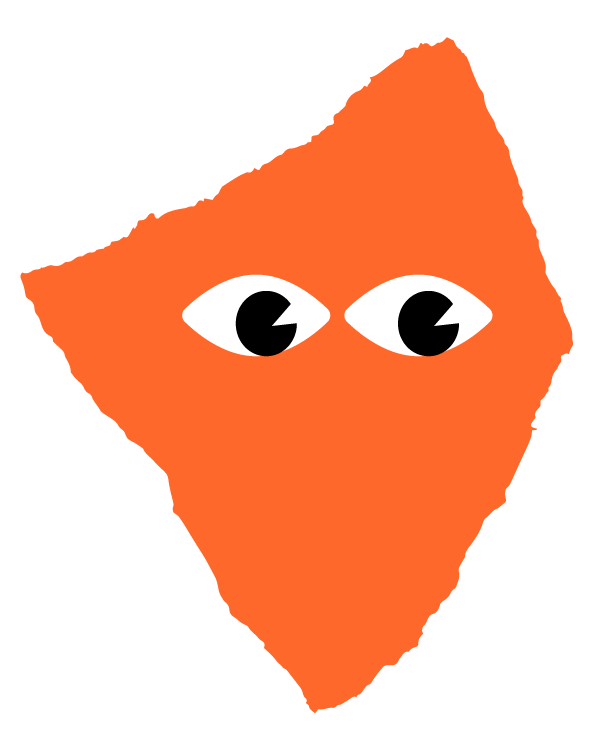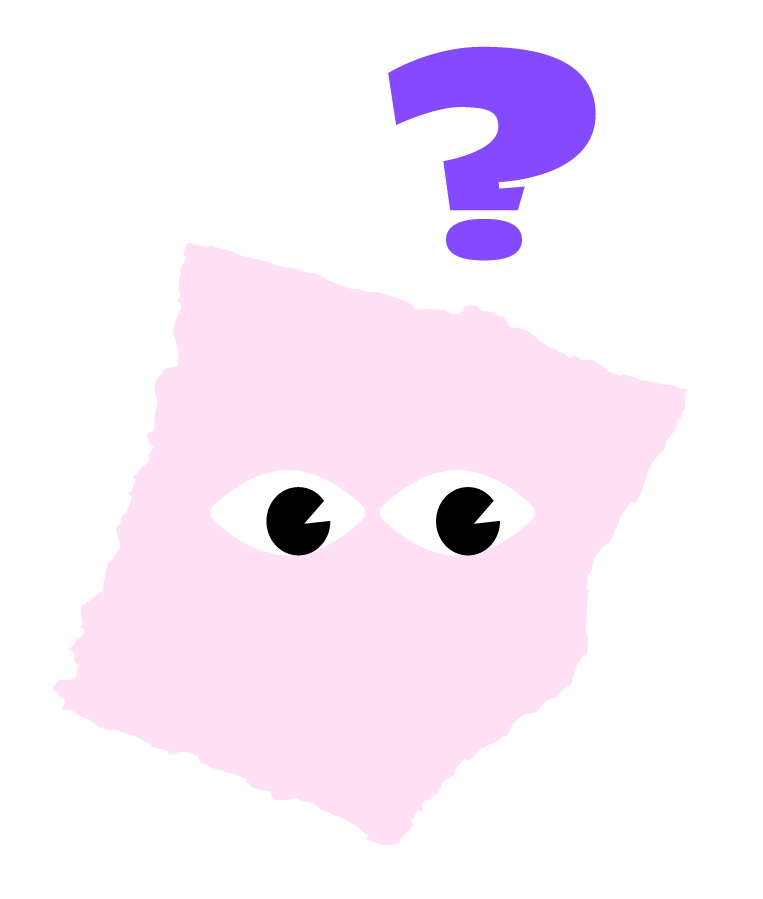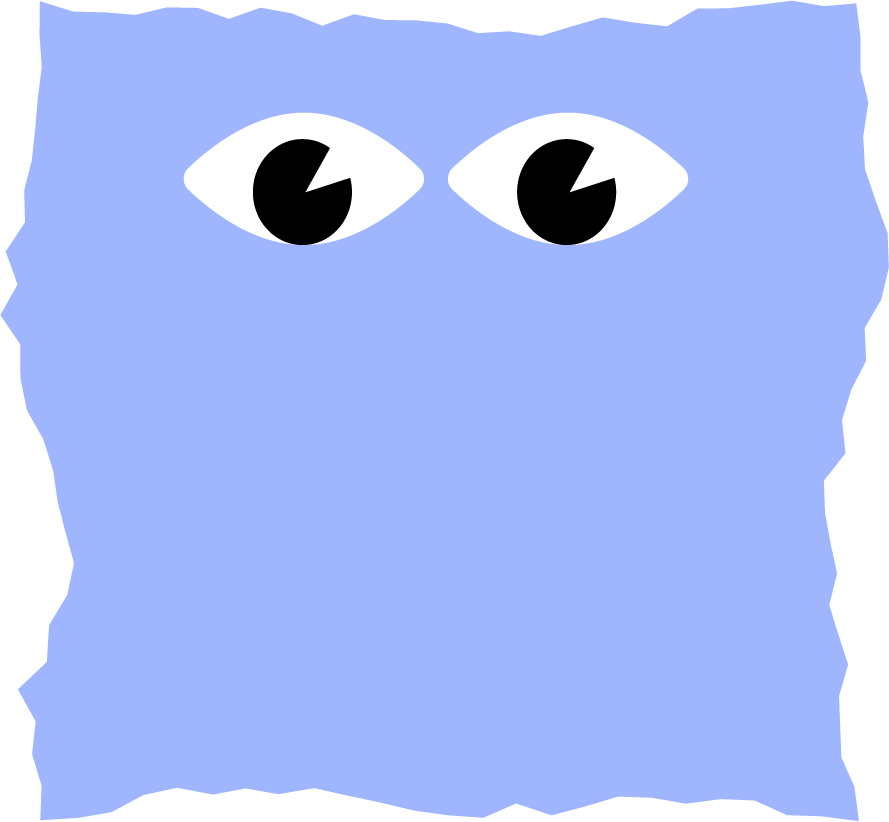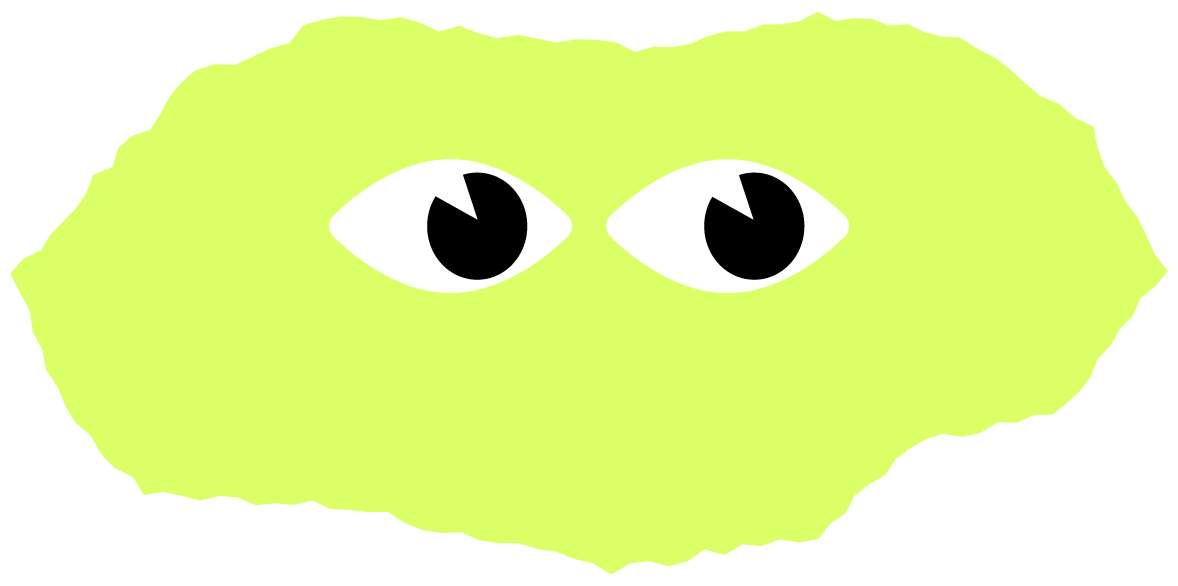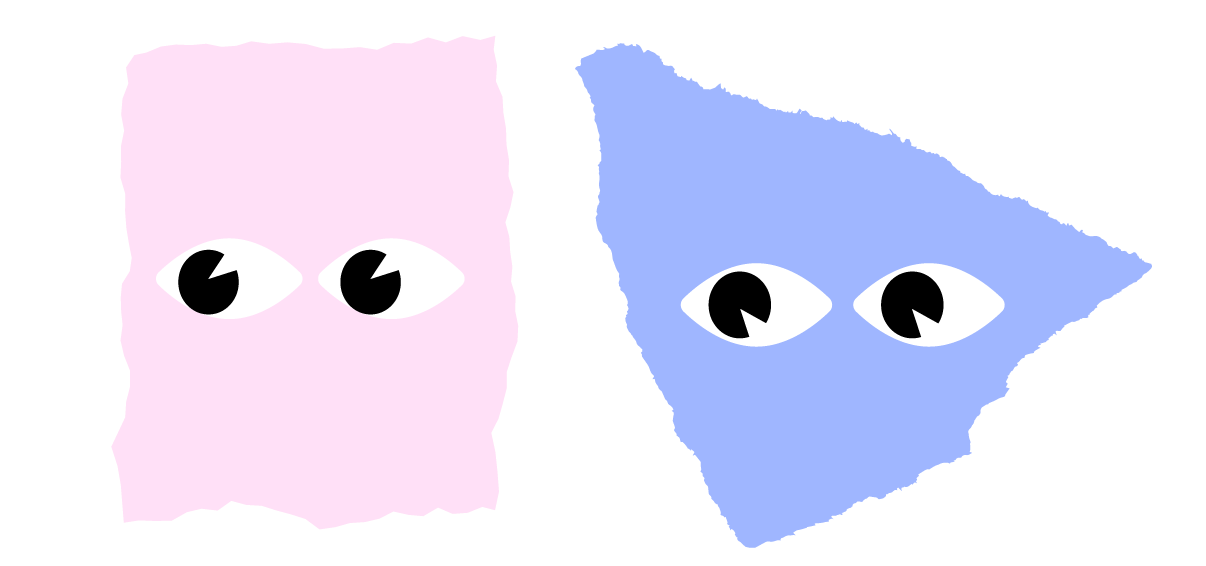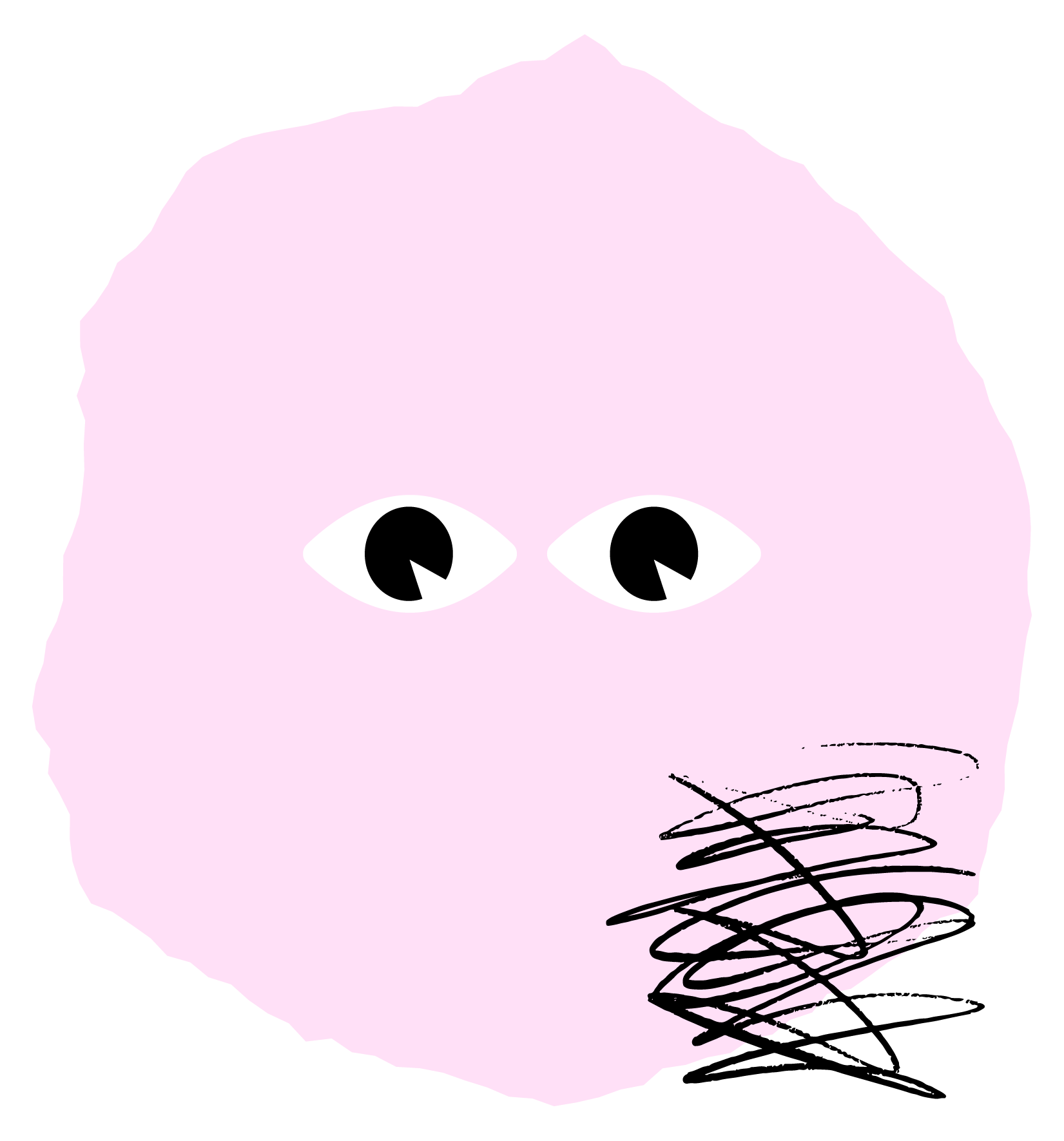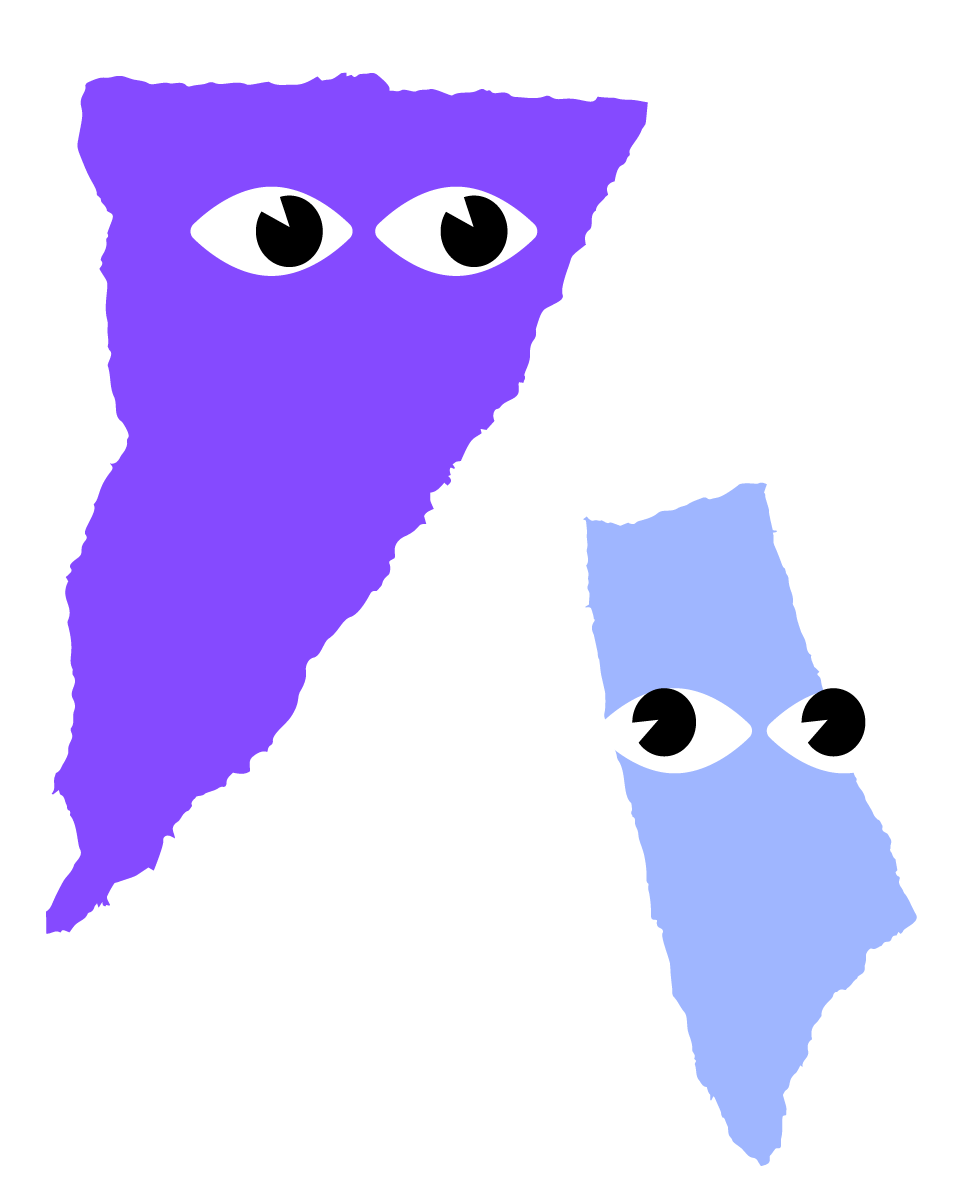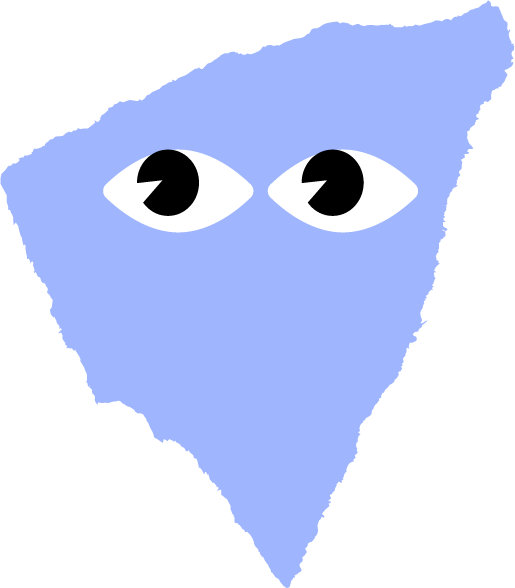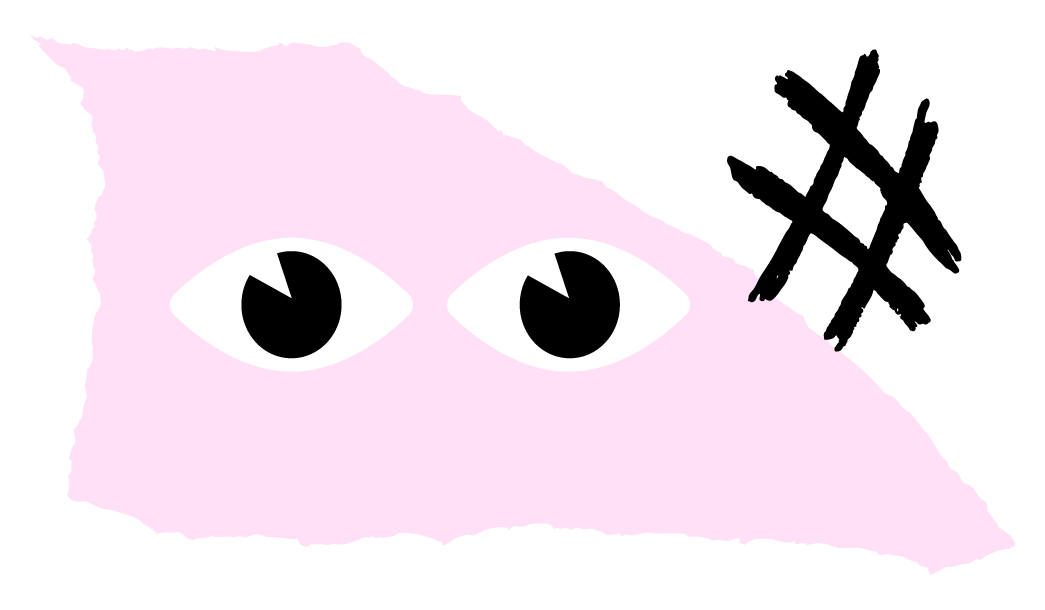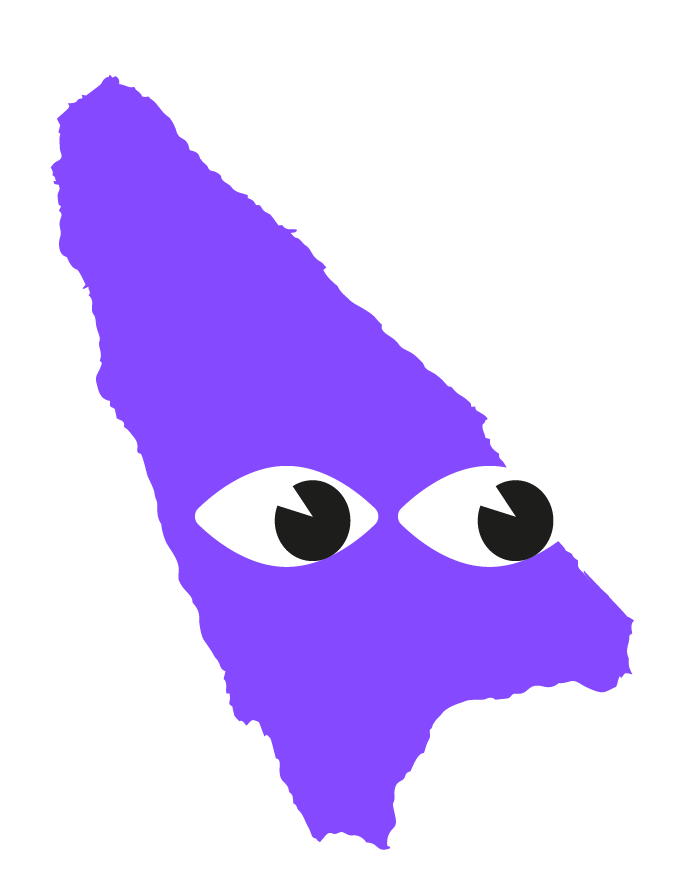Théories du complot
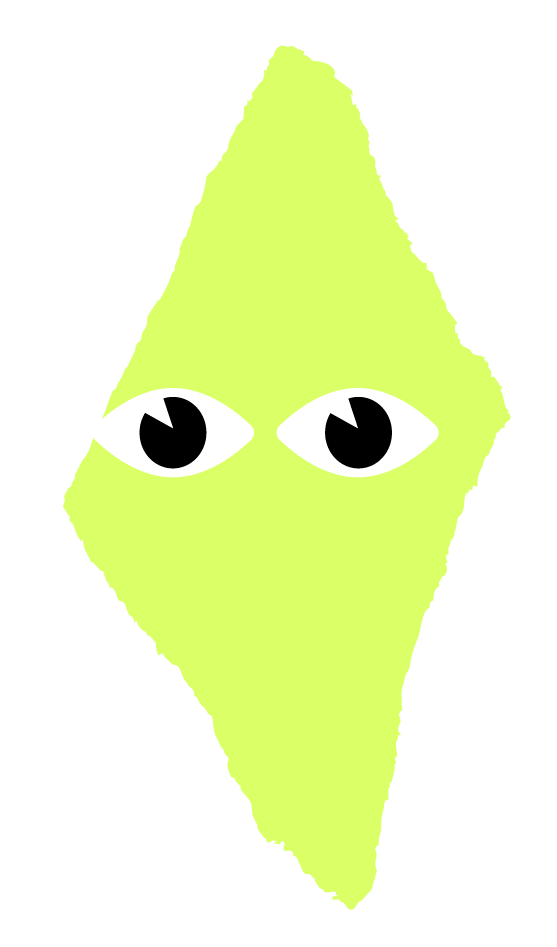
A l’âge d’internet et des réseaux sociaux, ces théories pullulent. Le plausible y côtoie le grand n’importe quoi. On y raconte, en vrac, que Mme Macron est un homme, que les Américains n’ont pas marché sur la Lune, que le président Kennedy n’a pas été abattu par un seul tireur et que les Russes manipulent les élections américaines.
Les personnes qui croient à une théorie du complot nourrissent un soupçon de conspiration : elles sont convaincues qu’un groupe de personnes, une organisation ou un gouvernement a conclu un accord secret dans le but de poursuivre une intention illégitime, souvent perçue comme « malveillante ». Le plus souvent, les gens qui diffusent ces théories les maintiennent quand on apporte les preuves du contraire.
Le grand problème, c’est qu’il y a dans cette la liste des histoires qui sont plausibles (les élections manipulées) et des histoires que l’on raconte différemment d’une époque à l’autre. Penser que le Covid a été créé dans un laboratoire était complotiste il y a quelques années. C’est aujourd’hui une question discutée dans de grandes revues scientifiques. La grande difficulté, c’est de faire le tri parmi ces théories parfois farfelues, mais parfois crédibles. C’est à cela aussi que servent les médias.
Ces personnes ne diffusent donc pas simplement de fausses informations : elles croient réellement à ce qu’elles racontent. C’est ce qui les distingue des auteurs de fake news, qui eux, créent volontairement de fausses informations tout en sachant qu’elles sont fausses.
Pourquoi le terme "théorie du complot" est-il en réalité inexact ?
Ce terme a évolué ces dernières décennies. Les amateurs de théories du complot étaient à la mode dans les années 1990, quand la série “X-Files” était extrêmement populaire.
Les deux héros de ce feuilleton, Mulder et Scully, y enquêtaient sur une série d’affaires qui sont considérées comme des théories du complot très répandues, notamment l’idée que les Etats-Unis cachent des restes de soucoupes volantes. Les attentats du 11 septembre ont changé la donne. Après la destruction des tours jumelles de New York, de nombreuses théories du complot sont apparues pour affirmer, par exemple, que ces attentats avaient été mis en scène.
Dès lors, l’intérêt pour ces histoires alternatives est devenu problématique, et les amateurs de théories du complot sont progressivement devenus des complotistes, très critiqués pour cela. Même si tout le monde l’utilise, le terme «théorie du complot» est en fait mal choisi. En science, une théorie désigne une explication construite à partir de données recueillies par des chercheur·euse·s. Une théorie scientifique cherche à expliquer ces données et reste ouverte à la remise en question : si de nouvelles données la contredisent, elle est modifiée ou abandonnée au profit d’une explication meilleure.
Les théories du complot, quant à elles, n’ont aucune base scientifique. Les personnes qui y croient refusent généralement de remettre en cause leurs convictions, même face à des faits qui les contredisent. C’est pourquoi on devrait plutôt parler de récits complotistes ou de mythes du complot.

Un exemple éclairant est celui de Juliette Binoche, actrice française mondialement connue, qui a suscité la controverse en relayant sur Instagram des contenus complotistes en lien avec la pandémie de Covid-19.
En 2021, elle a partagé plusieurs publications qui laissaient entendre que les vaccins à ARN messager faisaient partie d’un vaste plan de contrôle mondial, parce qu’ils allaient servir à placer une puce sous la peau des personnes vaccinées. Elle a également relayé des affirmations liant la 5G à la pandémie, une théorie complotiste largement démentie par la communauté scientifique.
Contrairement aux auteurs de fake news qui manipulent volontairement l’information, Juliette Binoche semble avoir cru à ces récits, ce qui l’inscrit plutôt dans une logique de « mythe complotiste » : elle ne ment pas intentionnellement, mais partage des idées auxquelles elle adhère sincèrement, malgré leur caractère infondé.
Cet exemple montre bien que même des personnalités respectées peuvent tomber dans le piège de la désinformation — et contribuer, parfois sans le vouloir, à la diffusion d’idées erronées.
En savoir plus
La rumeur relayée par Juliette Binoche selon laquelle Bill Gates voudrait réduire la population mondiale via les vaccins repose sur une déformation de faits réels.
La Bill & Melinda Gates Foundation soutient effectivement des campagnes de vaccination dans les pays en développement. Le but est de réduire la mortalité infantile : des enfants en meilleure santé signifient moins de décès, et donc moins de besoin d’avoir de nombreuses naissances.
👉 Conclusion
Ce n’est pas une tentative de “réduction forcée” de la population, mais une stratégie de santé publique à long terme qui permet aux familles d’avoir moins d’enfants, sans crainte d’en perdre.

Mais comment se fait-il que certaines personnes en viennent à croire de telles choses, et à défendre leurs convictions avec autant d’obstination ? Comment reconnaître une théorie du complot ? Et comment devrions-nous y réagir ?
Tu trouveras des réponses dans la vidéo suivante. Regarde-la attentivement, tu pourras ensuite répondre facilement aux questions qui suivent.
Quiz · Expressions complotistes
Quiz

Time's up
Pour aller plus loin...
Dans cette rubrique RTS, la chaîne explique comment naissent les rumeurs et comment elles peuvent évoluer en théories du complot. Ils analysent également les mécanismes psychologiques qui nous poussent à croire et à partager ces récits, en mettant en lumière des biais cognitifs tels que le biais de confirmation.
Pour éviter d’être submergé par des théories ou mythes du complot, il est important de faire attention aux sources d’information que tu consultes.
Des plateformes comme Facebook, YouTube ou Twitter signalent les contenus manifestement faux, voire les suppriment. Mais d’autres services sont beaucoup moins stricts. Un exemple typique : Telegram. Cette application de messagerie se vante de ne presque jamais censurer les contenus, ce qui en fait un terrain propice à la désinformation.
Médias alternatifs
Les médias alternatifs s’adressent à des groupes spécifiques en leur proposant des contenus qui ressemblent à de l’actualité, mais dont les convictions s’éloignent nettement de l’opinion dominante dans la société.
Lorsque ces groupes deviennent suffisamment nombreux et actifs, on parle parfois de « contre-public » ou « contre-espace médiatique ».
Les contenus de ces médias peuvent être diffusés sous plusieurs formes : imprimés, sites d’information alternatifs, ou encore newsletters envoyées par e-mail. Mais la plupart du temps, les personnes qui produisent ces contenus ne sont pas des journalistes de formation.
Le ton de leurs articles est souvent très critique vis-à-vis de la société ou des structures de pouvoir. Cela n’est pas nécessairement négatif : les médias journalistiques traditionnels posent eux aussi souvent des questions critiques sur l’évolution de la société, les décisions politiques ou les actions des grandes organisations.
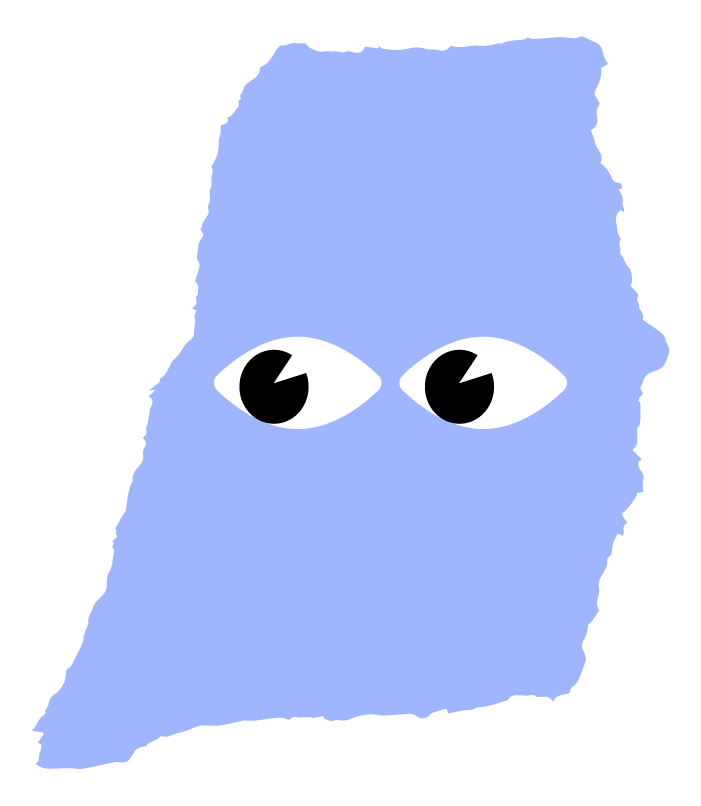
exemples de groupes
- Des écologistes radicaux ou des opposant·e·s à l’énergie nucléaire.
- Des personnes qui remettent profondément en question notre système économique.
- Les personnes qui doutent des bienfaits des avancées médicales.
Un exemple romand de média alternatif est le journal Moins!
Il s’adresse à un public écologiste, anticapitaliste et critique de la société de consommation, avec une orientation militante claire en faveur de la décroissance et de la sobriété volontaire.Même si son ton est engagé, les contenus sont sérieux, bien documentés, et s’appuient sur des faits vérifiables, dans une démarche de réflexion critique sur notre mode de vie et nos habitudes d’achat.
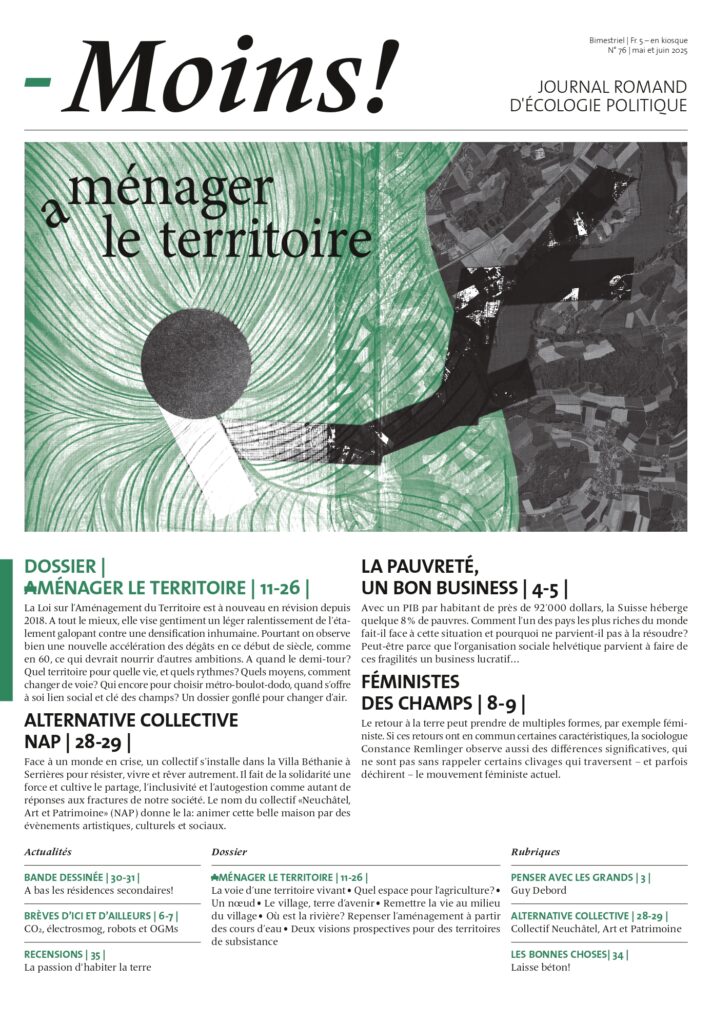
Il existe toutefois aussi des médias alternatifs problématiques, voire dangereux. C’est le cas, par exemple, du site AgoraVox, une plateforme française de « journalisme citoyen ».
Sa recette du succès ? Permettre à n’importe qui de publier des articles, souvent sans relecture journalistique ni vérification approfondie. Certaines publications s’appuient sur des faits réels – par exemple des études scientifiques ou des événements d’actualité – mais ceux-ci sont parfois déformés, retirés de leur contexte ou associés à des demi-vérités, voire à des contre-vérités.
Cela crée une image fausse mais crédible du sujet : le noyau de vérité donne l’apparence d’une information fiable, ce qui renforce la confiance des lecteurs, tout en suscitant l’indignation avec des éléments mensongers ou orientés.
Tu l’auras compris : on est ici aux frontières des fake news. La différence?
Les auteurs de ces contenus sont souvent persuadés de la véracité de leurs propos, ils ne cherchent pas forcément à manipuler, mais à défendre une vision du monde à laquelle ils croient profondément.
C’est ainsi que des plateformes comme AgoraVox, bien qu’ayant des intentions initialement ouvertes et démocratiques, peuvent devenir des vecteurs de désinformation ou d’idéologies complotistes.
Quiz · C'est quoi les médias alternatifs ?
Quiz

Time's up